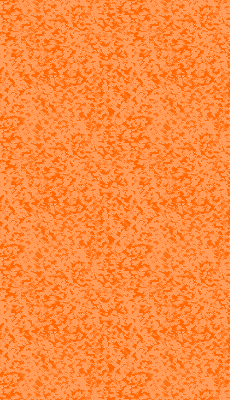
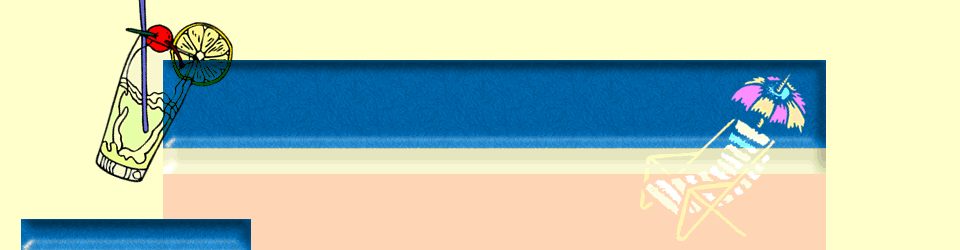

| Livre Papy |
La chronique d’un enfant du XXe siècle c’est l’histoire : d’un petit garçon à l’enfance mouvementée d’un adolescent livré très tôt à lui-même d’un adulte pris dans le flot de la guerre d’un travailleur aux multiples facettes d’un mari, père & grand-père heureux
Il y a soixante-quinze ans naissait à Paris, dans le cinquième arrondissement, un petit garçon pas très gros, parce que venu au monde à sept mois et demi. De plus, c'était la guerre. Il y avait à cette époque les bombardements sur la ville de la « Grosse Bertha », un énorme canon qui se trouvait dans la forêt de Compiègnes. On était en avril 1918.
Mon père étant à la guerre, ma mère, pour gagner sa vie et la nôtre, travaillait sur les tramways comme Wattman, c'est-à-dire receveuse. Elle ne put, de ce fait, me garder très longtemps. Aussi, elle me mit en nourrice quelques semaines après, chez Monsieur et Madame Pasquier, à Nantes.
* * *
1918 - 1925 : l’épisode nantais
Monsieur et Madame Pasquier étaient des gens très gentils. Ils avaient un fils, René, qui, contrairement à moi, était tout frisé. Ils habitaient 52 rue Condorcet, dans une grande et belle maison de ville. Maintenant, dans mes souvenirs, je peux la décrire.
Au rez-de-chaussée se trouvait une grande cuisine, au fond de laquelle il y avait un grand lit breton, avec deux portes pour le fermer. C'était là que dormait la mère de Madame Pasquier. Il y avait aussi une grande cheminée qui servait à préparer la majeure partie des repas. Dans la semaine, nous mangions tous dans la cuisine. A coté se trouvait la salle à manger, avec de très beaux meubles qui sentaient la cire. Elle était réservée aux repas du dimanche et de fêtes. Au premier étage, il y avait trois chambres : une grande pour Monsieur et Madame Pasquier, et deux petites pour les enfants. Un peu plus tard, en 1921, mon frère Louis est venu me rejoindre. Il était plus jeune que moi d’un an et demi et couchait dans ma chambre.
Au dessus, il y avait un grenier, dont une partie était(aménagée. C'est là que dormait le Grand-père Yan, que nous appelions « Père Jean ». Il était le mari de la mère de Madame Pasquier. C'était un ancien marin qui avait fait le tour du monde sur les voiliers et avait passé le Cap Horn, comme il nous le racontera plus tard. Cet homme était assez âgé. Pourtant, il travaillait comme tailleur de pierres dans une carrière, car, à cette époque, la retraite n'existait pas.
Cette famille comprenait donc Monsieur et Madame Pasquier, la mère de Madame Pasquier, son mari le père Jean et le fils René. La mère, nous l'appelions « Nainnain ». Je n'ai jamais su son véritable nom. C'est elle qui s'occupeit de la cuisine, aidée par sa fille. Fait curieux : ni Nainnain ni son mari ne mangeaient à table. Lui restait près de la cheminée et elle debout, tout en nous servant. Maintenant, avec du recul, je trouve que les gens à cette époque, étaient durs avec les personnes âgées.
C'est à partir de quatre ans quu mes souvenirs commencent. Derrière la maison, il y avait un grand jardin coupé en deux. Le côté maison était d'agrément, avec de grands arbres, une charmille et des noisetiers tout au fond. Nous y allions les après-midi d'été car il y faisait bon. L'autre côté était réservé au jardinage. Il y avait des arbres fruitiers et plein de carrés de légumes différents. C'était le domaine du père Jean, qui, en plus de son travail à la carrière, y faisait pousser de nombreux fruits (fraises, framboises, cassis) et des légumes (petits pois, haricots, tomates, carottes, pommes de terre). Le tout poussait bien car le père Jean prenait soin du potager.
Au fond, il y avait une sorte de hangar où étaient élevés des poules et des lapins. C'est dans ce hangar que l'on faisait les grandes lessives de printemps et d'automne. C'était surtout le gros linge de maison, c’est-à-dire les draps, les torchons et les serviettes. Des femmes venaient aider à cette lessive. Le linge bouillait dans de grandes cuves avec de la lessive et des cendres de bois, était brossé avec des brosses a chiendent et battu au battoir. Il était ensuite rincé à l'eau courante par l’ouverture à l'arrière du hangar, qui donnait sur une petite rivière. Enfin, il était étendu sur de grandes cordes ou sur des haies, avant d'être repassé et rangé dans de grandes armoires où il y avait, à cette époque, beaucoup de draps et de linge de maison.
Je me souviens aussi des confitures que l'on faisait vers le mois de juin ou au début de juillet. Tous, femmes et enfants, nous aidions à l'égrainage des groseilles ou au nettoyage des fraises. Pour les cerises, les enfants les triaient et les équeutaient, le dénoyautage, plus difficile, étant fait par les femmes. Ces confitures se faisaient dans de grandes bassines en cuivre.
Dans mes souvenirs de cinq à six ans, je me rappelle les jeudis d'hiver, où le Père Jean nous emmenait dans sa chambre pour nous raconter ses voyages. Il ouvrait so~ coffre de marin pour en sortir plein de choses et nous parlait de pays lointains. Il nous captivait. Nous avions l'impression de voyager avec lui.
L'école où je suis allé à partir de l'âge de cinq ans, se trouvait à deux kilomètres de la maison. Nous étions plusieurs enfants du voisinage à y aller. Nous longions un petit ru qui n'était qu'un filet d'eau. Quelquefois, j'ai fait l'école buissonnière. Avec les autres gamins, je retirais mes chaussures et mes chaussettes et je tentais d'attraper des têtards, sans y parvenir. Un jour, le maître d'école a prévenu Madame Pasquier de mes absences à l'école et j’ai pris une bonne fessée. Après cette punition, j’ai voulu me venger. Comme c'était la période des grandes lessives, j’ai mis des braises dans une caisse en bois et je les ai portées sous la voûte de la maison, qui conduisait à la cave. Cela fit beaucoup de fumée mais seule la caisse brûla. Là, le Parrain, me frappa encore plus fort et m'envoya me coucher sans manger. Alors je n’ai plus jamais recommencé.
En ce temps là, il n'y avait pas de cantine à l'école. Aussi , en plus du cartable, nous avions un panier en osier dans lequel se trouvaient deux grosses tartines de pain, recouvertes de saindoux ou de beurre saupoudré de chocolat, et une pomme du jardin. Nous mangions dans la cour de récréation ou bien, les jours de pluie, sous le préau.
Il me faut dire ici que mes parents nourriciers étaient devenus « Parrain » et « Marraine ». Mon Parrain était machiniste au théâtre de Nantes. Nous y sommes allés plusieurs fois lorsque j'avais six ans. C'étaient des pièces à grand spectacle, comme « Michel Strogoff », et d'autres dont je ne me souviens plus.
Pas très loin de la maison, il y avait un grand jardin public. On y voyait des biches et toutes sortes d'oiseaux, dont des perroquets sur leurs perchoirs, des cygnes et des canards dans un petit lac. Il y avait de très grands arbres, dont certains étaient centenaires. L'été, nous y allions très souvent dès le matin pour jouer à l'ombrg des arbres. Il y faisait très bon. Il m’est arrivé d’y aller seul avec René, car mon frère était trop petit.
En 1924, la petite rivière qui se trouvait derrière le jardin déborda et il y eut plein d'eau dans la cour . Du fond du hangar, les cuves vides et les baquets où on lavait le linge voguaient, à la plus grande joie des enfants. Mais, pour les grandes personnes, ce n'était pas pareil car, dans les clapiers, plusieurs lapins étaient morts, ainsi que quelques poules.
Jusqu'en 1925, je fus très heureux. Mais tout a une fin. Ma mère n'ayant pas payé depuis plusieurs mois les frais de nourrice de mon frère et de moi, nous avons dû être renvoyés à Paris. Nous avons pris le train à Nantes avec deux baluchons de vêtements et un édredon. Ce dernier était un cadeau de la bonne Nainnain. Mon Parrain eut beaucoup de mal à le caser dans les filets qu’il y avait au dessus des banquettes. Nainnain pleurait avant notre départ car elle nous aimait bien.
Nous avons voyagé toute la journée jusqu’à Paris, Gare des Invalides, car à cette époque les trains venant de l'ouest arrivaient là. Les voyageurs nous ont aidé à descendre nos bagages, et là, sur le quai, nous avons attendu notre mère, qui est arrivée une bonne demi-heure après. Elle ne connaissait pas l'heure du train.
* * *
Paris, 1925 - 1926
Notre mère nous emmena là où elle habitait. C'était un hôtel dans la rue Marie Stuart, près de la rue Sainte-Opportune. Cela se trouvait à coté des Halles. L'immeuble était assez vieux et nous n'avions qu'une seule chambre au deuxième étage. Mon frère et moi, nous couchions au pied du lit et ma mère à la tête.
Il faut dire que ma mère était divorcée depuis 1921, car, dans les dernières années de la guerre, elle avait connu un autre homme. En fait, mon frère Louis n'était que mon demi-frère, et mon père ne l'avait pas accepté en revenant de la guerre. Je sus, bien plus tard, que j'avais deux autres frères et une soeur plus âgée, mais j'y reviendrai un peu plus loin.
Nous étions à la fin du mois de septembre. Aussi, au mois d'octobre, nous sommes entrés à l'école communale rue Etienne Marcel. Dans la classe où j'étais, le maître s'aperçut bientôt que je ne savais ni lire ni écrire. Heureusement pour moi, c'était un brave homme. Comme nous restions le soir à l'étude jusqu'à 6 h, après la récréation de 4 h, il me prenait à part. C’est lui qui m’a appris à lire et à écrire. Les instituteurs de ce temps là aimaient bien leur métier.
A cette époque, la cantine n'existait pas encore et nos tartines, à mon frère et à moi, n'étaient pas très grosses, avec une barre de chocolat. C'était tout.
Ma mère, à cette époque, travaillait dans un atelier où/l'on faisait des chemises. Elle était spécialiste des cols. Plus tard, il y eut les chemises à cols tenants. Elle ne gagnait pas grand chose.
Le samedi soir, nous allions souvent au théâtre Comme elle connaissait plusieurs chefs de claques, nous nous mettions au poulailler, tout en haut du théâtre. Là, nous donnions le signal des applaudissements. Nous étions une vingtaine de personnes. Nous avons vu André Bauge dans « le Petit Duc » à la Porte Saint-Martin, puis « la porteuse de pain » à l'Ambigu, « les Mousquetaires au Couvent » à la Gaîté Lyrique et bien d'autres pièces, car ça changeait souvent.
A cette époque, ma mère, qui était grande et encore assez belle, avait un ami sérieux qu'elle voyait une fois la semaine. Alors, pour être tranquille, elle nous payait le cinéma. Les salles de quartier n'étaient pas très chères : un franc cinquante à deux francs la séance. Tous les films en ce temps là étaient muets et, en dessous de l'écran, il y avait un pianiste qui ponctuait l'action par une musique appropriée.
Parfois, ma mère nous emmenait sur les Grands Boulevards et revenait nous chercher deux heures plus tard. Au moment des fêtes de Noël, il y avait plein de petites baraques en bois avec des jouets, des loteries et des camelots qui présentaient des tas de choses. On s'amusait bien à écouter leurs boniments. Il y avait aussi les chanteurs ou chanteuses des rues avec un accordéoniste. En les écoutant chanter, on apprenait les chansons. Ils vendaient les chansons nouvelles un franc et les recueils de dix chansons anciennes, deux francs. En fait, c'était le spectacle dans la rue.
Et puis un jour, le monsieur que ma mère connaissait nous emmena chez lui. C'était un bel appartement. Là, nous regardions de beaux livres d'images. Il nous offrit « Vingt mille lieues sous les mers » de Jules Verne. C'était un peu dur à lire car je n'étais pas encore très fort en lecture.
* * *
1927 - 1930 : Les années de pension
Au mois d'avril, pour mes huit ans, nous fûmes mis en pension au Perreux, 22 rue de Bellevue. Cette pension, Perretti Escache, qui faisait le coin de la rue Denfert-Rochereau, était un établissement pour pupilles de la nation. Notre mère avait réussi à faire passer le divorce par la guerre, ce qui lui permettait de ne pas payer trop cher.
Il y avait trois classes : les petits, les moyens et les grands pour le certificat d'étude. Le matin, lever 5 h 30, toilette, étude de 6 h à 7 h 30, puis petit-déjeuner, où l’on nous servait de la soupe. Dedans il y avait une cuillerée d'huile de foie de morue Au début, je ne pouvais pas la manger. Mais petit à petit, comme j’avais faim, je m'y suis habitué. A la récréation, il y avait une grande brute qui battait tout le monde. Un jour, il prit mon frère à partie. Je lui suis tombé sur le dos et nous nous sommes battus. Il était plus fort que moi, aussi j'ai pris une bonne rossée. Mais après ce fut mon meilleur copain.
La classe commençait à 8 h. J'étais dans la deuxième. Au début, j'eus du mal à m'y faire. Mais grâce à l'étude du matin et du soir, où nous révisions, ce fut plus facile. Les repas du midi et du soir étaient immuables : toujours lentilles, pois cassés, riz au gras, haricots blancs ou pommes de terre en robe des champs, un peu de viande le midi, une soupe le soir et parfois du riz au lait. Le pain était rassi à souhait. Comme boisson, nous avions une tisane nommée « bourdaine », qui permettait de ne jamais être constipé. A 4 h, il y avait un goûter. Ceux qui avaient du chocolat de leurs parents étaient gâtés. Mais nous étions quelques uns à manger notre pain sec. A 7 h du soir, nous nous lavions et faisions notre lit, qui était resté à l'air toute la journée, été comme hiver. Aussi, quand il faisait froid, nous avions du mal à nous réchauffer, car nous n'avions qu'une couverture.
Le samedi après-midi, il y avait douche et l'on changeait de chemise, de culotte et de chaussettes, ainsi que notre blouse grise. Eté comme hiver, c'était notre habillement. Certains avaient des pulls, mais pas nous. Aux pieds, nous avions des galoches avec de gros clous en dessous. Au début, cela me faisait mal, mais on s'y habitue. Pour les sorties, chacun de nous avait un habit bleu marine avec des boutons dorés, une casquette à galons dorés et une pèlerine.
Il y avait des élèves qui sortaient le samedi après-midi et qui revenaient le dimanche soir. Cela ne nous est pas arrivé à mon frère et à moi. Ceu| qui restaient étaient gardés par un pion, et, après une récréation d'une ou deux heures suivant la saison, nous retournions en classe.
En quatre ans, nous n’avons vu notre mère que trois ou quatre fois...
Par contre, nous avons eu la chance de connaître Paul, qui était notre frère aîné de sept ans, car il est venu nous voir plusieurs fois le dimanche. Il était très gentil car il nous apportait des bonbons et nous emmenait au cinéma le Palace, pas très loin du Pont de Mullouse. Nous y avons vu, entre autres, « Le Fantôme du Louvre » et, je crois, « Les cinq sous de Lavarède ». Il est venu une ou deux fois avec ma soeur, Marthe, qui avait quatre ans de plus que moi. Ils travaillaient tous les deux, lui sur les marchés, à vendre des fruits et légumes, et elle comme apprentie, mais je ne sais pas où.
Paul nous apportait aussi tout un tas de livres : des petits fascicules de la « Grande Guerre » 14-18, qui étaient très à la mode en ce temps là (c'était la collection « Patrie ») et puis des grands livres toujours très illustrés, tels que « Kit Carson Policier », « Lord Lister Gentleman Cambrioleur ». Je lisais le soir, en été bien sûs, car l'hiver il n'y avait que la veilleuse, donc pas assez de lumière. Je cachais tous ces livres à l'intérieur de mon matelas, que j’avais décousu, mais il y eut une inspection des chambres et ma cachette fut découverte. J'eus droit à deux cents lignes pour me punir et mes livres furent confisqués.
Dans les dortoirs, nous dormions à quarante sous la garde d'un surveillant, qui avait pour séparation un rideau en toile blanche. Il y avait trois dortoirs, ce qui faisait cent vingt élèves environ, parfois plus. Nous apprenions trìs bien. Les leçons étaient très importantes, autant en Histoire qu'en Français ou en Géographie. Chaque jour, nous devions apprendre deux ou trois pages de chaque. Grâce aux heures d'études très prolongées, nows y arrivions.
Comme j'avais une bonne mémoire, je n'étais pas dans les derniers. La deuxième classe, où je suis resté deux ans, était tenue par la femme du Directeur. Lui s'occupait de la classe du certificat d'étude. Il avait assez de succès, car il étiit un excellent professeur.
Pour les vacances de Noël ou de Pâques, presque tous les élèves partaient. Nous étions seize ou dix-sept à rester, toujours les mêmes, alors on nous groupait dans une seul dortoir, sous la garde d'un surveillant. Ces jours là, j’avais(beaucoup de peine. Une année, ce fut un Bulgare qui était venu apprendre le français. C'était une grosse tête car, au bout de trois mois seulement, il se débrouillait fort bien. Pour le réveillon de Noël 1928, il nous fit du thé et%nous raconta les légendes de son pays. Ce fut un de nos meilleurs Noël. Le jour de Noël, nous avions une orange et deux ou trois gâteaux au dessert de midi. Ce repas était un des meilleurs.
Pendant ces vacances, nous avions droit à la Bibliothèque. Aussi, j'en profitais. J'ai dû lire presque tous les livres de Jules Verne, dont le plus beau est, à mon sens, « Les enfants du Capitaine Grant ». J'ai lu aussi « Les trois Mousquetaires » et « Vingt ans après » d’Alexandre Dumas. Et mon frère Paul continuait de m'apporter des livres, que je rangeais sous mon pupitre. Quand je les avais lus, je les donnais à mon frère Louis.
Ce Noël là, Paul m’apporta « Vingt mille lieues sous les mers ». Nous reçumes également de notre Marraine deux belles écharpes pour la nouvelle année, ce qui nous fit très plaisir, car, cette année là, l'hiver fut très rude.
Au printemps 1929, quarante élèves attrapèrent la teigne, une maladie du cuir chevelu qui fait tomber les cheveux. Elle nous fut apportée par deux élèves grecs, les frères Costouglou. Aussi, nous nous sommes retrouvés pendant deux mois à l'Hôpital Saint-Louis, qui est spécialisé dans toutes les maladies de peaux. On nous mit une pommade noire pour faire tomber les cheveux et lorsqu'il n'y en eut presque plus, on nous passa à l'épilation pour enlever les duvets qui restaient. Après, on avait l'air de vraies têtes de veau. Au mois de mai, nous sommes rentrés à la pension. Tous les autres élèves se moquaient de nous. Au bout de quelques temps, les cheveux repoussèrent, et, comme les élèves étaient rasés tous les deux mois, nous étions enfin pareils.
Dans toutes les écoles, la distribution des prix avait lieu aux environs du 14 juillet. Puis c'étaient les Grandes vacances. A la fin juillet, la plupart d'entre nous partaient dans la Manche, à Champeaux, dans une colonie qui appartenait à Madame Perretti. C'était tout près de la baie du Mont Saint-Michel. Nous prenions le train vers 10 h du soir pour arriver à Granville à 6 h du matin. On nous donnait pour le petit-déjeuner un petit pain frais avec une barre de chocolat. Que c'était bon ! Nous prenions ensuite un train qui longeait la côte. On apercevait la mer à plusieurs endroits. Que c'était beau !
Arrivés au château, qui en fait était plutôt une bâtisse avec un immense jardin, nous trouvions d'autres élèves qui venaient de la pension Saint-Nicolas. Il y eut bien sûr quelques bagarres au début, mais tout rentra dans l'ordre dès l'après-midi, où nows partîmes nous baigner sur la plage de Saint-Jean-le-Thomas. Il fallait faire attention car, quand la mer montait, elle avait vite fait de vous entourer. A cette époque, elle était très dangereuse. Depuis qu'il y a la digue du Mont Saint-Michel, la mer monte moins haut mais la plage est moins belle, car il y a beaucoup de galets. Nous trouvions, dans le sable, des coques et des petites palourdes, que nous mangions crus. Nous sommes allés aussi aux Falaises de Champeaux. C'est là que j'ai appris à nager. Les promenades du dimanche nous emmenaient vers Avranches ou vers Carolle. Nous revenions souvent fourbus.
Dans les chambres, suivant la grandeur, nous étions quinze à vingt sur des matelas posés par terre, les uns près des autres. Les repas étaient pris en commun dans une grande salle. C'était un peu meilleur qu'en pension. Le matin : une sorte de café au lait avec du pain ; le midi : viande et légume. Nous buvions du cidre avec de l'eau. Le soir : soupe de légume et fruit ou riz au lait. Enfin, c'était bien.
On passait dans cet endroit un mois et demi. Dans les grandes marées du mois d'août 1929, nous sommes allés au Mont Saint-Michel à travers les sables en partant de la plage des Genêts (les grands seulement). Nous avions un guide car il ne fallait surtout pas s'écarter du chemin à cause des sables mouvants. Nous partions le matin avec chacun du pain, de la viande froide et une pomme. C'était assez fatigant. Que dire encore de ces vacances ? On prenait parfois le train pour visiter Granville et son port de pêche. Nous y avons vu de très beaux bateaux, ceux qui allaient à cette époque à la pêche en Islande. Cela a disparu depuis très longtemps.
Vers le 15 septembre, chacun retrouvait sa pension : nous, Perreti Escache, et les autres, Saint-Nicolas. Pendant notre absence, tous les dortoirs avaient été passés au souffre et les lits de fer au pétrole, car il y avait des punaises. Mais, malgré toutes ces précautions, elles revenaient au bout de quelques semaines pour nous dévorer la nuit. On ne les sentait plus car on y était habitués.
Dans cette pension, même le jeudi, nous étions à l'étude et les leçons devaient être sues par coeur, ainsi que les récitations. La Fontaine, Victor Hugo ou Racine n'avaient pas de secrets pour nous. L'après-midi, nous allions nous promener le long de la Marne, soit vers la Maltournée, qui était le dépôt des Tramways, soit du côté de Brie-sur-Marne. Il y avait un petit bois où nous jouions à cache-cache ou bien à la guerre. Nos promenades nous menaient aussi parfois au champ de course du Tremblay. Nous sommes même allés plusieurs fois au Bois de Vincennes du côté de la Porte Jaune. Cela faisait une sacrée ballade ! Le soir, nous étions fourbus.
Quand il pleuvait, le jeudi, nous avions cinéma. Le Directeur de l’école avait acheté un appareil de cinématographe Pathé Baby, dont on tournait la manivelle à la main. Nous avons vu des petits films de Charlot, tels que « Charlot Emigrant », « Charlot Noctambule », « Charlot Policeman », « Charlot Soldat », etc. Nous eûmes également des films de Harold Lloyd, « Doublepatte et Patachon », ainsi que « Les Misérables » de Victor Hugo en épisodes. Evidemment, tous ces films étaient muets et commentés par le maître. On avait droit à deux ou trois films, car ils ne duraient que quinze à vingt minutes chacun.
Près de la pension, au mur mitoyen, habitait un des frères Fratellini, Albert. Parfois, l'été ou à Pâques, par dessus ce mur, il nous jouait la comédie avec un ou deux de ses frères. C'était très drôle ! Dans le fond, on ne s’ennuyait pas trop.
En 1929, il y eut un très grand froid et une épidémie de diphtérie. Beaucoup d'entre nous furent malades. On nous fit des gargarismes tous les matins et tous les soirs et cela ne dura pas. J'ai passé en tout quatre ans et demi dans cette pension, d'avril 1926 à août 1930. Malgré mes bonnes connaissances, j'ai échoué au certificat d'études pour cinq fautes à la dictée.
* * *
1930 - 1939 : Premiers pas dans la vie d’adulte
En revenant de vacances, mon frère est resté à la pension mais moi, ma mère me reprit dès le mois de septembre et me mit en apprentissage chez un boucher, Monsieur Boireau, rue de la Roquette. J’avais douze ans et demi. J'aurais préféré la serrurerie mais il fallait payer l'apprentissage, ce que ma mère ne pouvait pas faire. Là, j'étais payé trente francs par semaine et je recevais quelques pourboires par les livraisons. Nous habitions 1 rue Saint-Maur, au sixième étage, un petit deux-pièces avec une entrée. C’est dans l'entrée que je couchais, dans un lit-cage que l'on dépliait tous les soirs. Ma mère était en ménage avec un mutilé de la guerre 14-18 qui s'appelait Victor. Il avait perdu une jambe et était blessé au cou. Les premiers mois, ce fut assez dur, car je devais me lever à 4 h du matin, pour ne rentrer le soir que vers 20 h 30. J'étais encore en culotte courte. Tous les chefs et les seconds, ainsi que le patron, m'appelaient « l'Agneau ». Mon travail consistait à laver les marbres d'étalage, balayer la boutique, casser les os, aller chercher les commandes chez les clients puis faire les livraisons. Nous avions aussi comme clients les cantines de deux écoles et une charcuterie. Comme je n'étais pas très grand à l'époque, les ouvriers-charcutiers me firent bien des niches.
J'ai commencé à apprendre le métier un peu plus tard. On commence toujours par le désossage d'un collier de boeuf, ce qui est très difficile. En plus, étant gaucher, ils me tapaient sur la main pour me faire travailler de la main droite. Mais dès qu'ils ne regardaient pas, je reprenais la main gauche, ce qui me permit de travailler des deux mains.
A l'hiver, j'eus mes premiers pantalons longs. Souvent, le dimanche, ma mère venait chercher ma paye car, avec Victor, ils allaient jouer aux courses. Heureusement, je gardais tous mes pourboires, ce qui me permettait d'aller au cinéma. Il m'est arrivé fréquemment, le lundi, de ne pas avoir de quoi manger à la maison, car le jeu ne rapporte pas très souvent.
Comme le patron, Monsieur Boireau, allait souvent à la campagne, il me demanda si je voulais bien, le dimanche soir et le lundi, mettre en route le frigorifique qui, en ce temps là, marchait par rhéostat. Grâce à cela, je pouvais manger dans la cuisine. Je l'arrêtais au bout de deux ou trois heures en revenant du cinéma, de mes visites dans les musées ou bien, quand il faisait beau, de mes promenades dans Paris, au Jardin des Plantes ou aux Buttes-Chaumont.
Les hivers 1930 et 1931 furent très froids. Aussi, dans la boutique, il y avait un brasero, mais la viande était glacée. En mai 1931 eut lieu l'exposition coloniale, à l'entrée du Bois de Vincennes. On ne payait l'entrée que six francs. J'y suis allé souvent le lundi, dès le matin, avec mon casse-croûte, ce qui me permit de visiter beaucoup de pavillons, dont le clou était « le Temple d'Angkor Vat ». Il y avait également beaucoup d'attractions. Ce n’était pas très cher, aussi je suis monté dans presque toutes. C'était vraiment merveilleux !
Je suis resté deux ans dans cette boucherie, jusqu'en juillet 1932. Comme je n'apprenais pas grand chose et qu'en plus, un dimanche, ma mère n'est pas venue chercher ma paye, j'ai demandé mon certificat et je suis parti. C’est à ce moment là que j’ai quitté ma mère. Elle m’a émancipé pour que je puisse vivre seul.
De quatorze ans et demi à vingt-et-un ans, j'ai fait pas mal de boucheries différentes, avec des hauts et des bas. Ce fut dur au début mais cela m'a appris le métier. Il fallait faire aussi des livraisons en vélo, en triporteur. J'ai ainsi visité les grands restaurants des Champs-Elysées ou des Grands Boulevards (le Poccardi, le Fouquet's, le Florian) ainsi que les gares dont la restauration était renommée, telle la Gare du Nord ou celle d'Orsay. Mais j'étais mieux payé et, en plus de commis, je devins second.
J’ai une anecdote à propos du Chef de la Gare du Nord. Celui-ci était très difficile et refusait presque toujours quelque chose, par exemple un faux-filet, ne le trouvant pas assez beau. Tous les autres livreurs ramenaient alors le faux-filet à la boucherie. Moi, je commençais toujours mes livraisons par la Gare du Nord puis je repassais à la fin de la tournée avec le même morceau. Et là il disait toujours : « celui là est très bien ». Ce qui prouve que c’est la foi qui compte...
En 1934, il y eut beaucoup de scandales en France. Les plus importants furent l'affaire « Stavisky » et celle « des Cagoulards », ce qui entraîna bien des changements dans le Gouvernement.
En 1935, malgré le désaccord de la Société des Nations, les Italiens envahirent l'Ethiopie en chassant les nègres, ce qui permit à ce pays, dirigé par un roi fantoche et par Mussolini, d'avoir un ensemble de colonies avec l'Erythrée et la Somalie.
1936 vit l'avènement du Front Populaire, ainsi que l'élection de Léon Blum comme Premier Ministre et de Léo Lagrange aux Loisirs. Pour les français, ce fut l'embellie : les congés payés pour tous les ouvriers, la loi de quarante heures et des salaires meilleurs. Evidemment, dans la boucherie, nous faisions encorg quarante-huit heures, mais nous avions obtenu de ne commencer le travail qu’à 6 h du matin, au lieu de 4 h ou 5 h. L'après-midi, nous avions deux heures pour nous reposer. Enfin, nous réussîmes également à décrocher un salaire plus intéressant.
Cette année là, aux mois de juillet et août, on vit sur les routes les gens qui partaient à la mer ou à la campagne à vélo, en tandem ou par le train. Léo Lagrange avait crëé les premières auberges de jeunesse et instauré deux semaines de vacances, ce qui ne plaisait pas à la bourgeoisie française. Aussi, les capitaux ont fui en Suisse, mettant le premier Gouvernement Populaire en difficulté.
Cette année là, il y eut beaucoup de grèves, car les patrons n'acceptaient pas les nouvelles lois. Les usines et les commerces fermèrent plusieurs jours au mois de juin. Il y eut plus de huit mille grévistes. Après de longues discussions, et des concessions de part et d'autre, le contrat collectif fut accepté et le travail reprit en août. Mais, un mois après, les patrons le dénoncèrent. Nous fûmes quelques uns à refaire grève, mais, comme nous n'étions pas très nombreux, cela ne dura pas. Nous fûmes mis à la porte presque tous, marqués à l'encre rouge dans les officines de placement. Alors, pour trouver du travail, je suis allé aux Halles. Dans l'ensemble, cela marchait bien, car je trouvais de très bonnes places. Mais je changeais très souvent.
Et puis, ce fut la guerre d'Espagne. Ce pays était une République depuis 1931. Cela ne plaisait pas au Général Franco, qui, à la tête des Nationalistes, entra en Guerre contre le Gouvernement Populaire. Cela dura jusqu'en 1939. Il fut aidé en cela par les fascistes italiens et par les Allemands totalitaires du Chancelier Hitler, dont l'aviation détruisit plusieurs villes. Parmi elles : Guernica. Si les républicains rasèrent beaucoup d'églises et tuèrent des curés, les nationalistes, eux, détruisirent aussi pas mal de choses et assassinèrent le grand poøte Federico García Lorca. Ce fut un combat fratricide où, de chaque côté, il y eut beaucoup d'exactions. Vers la fin de la guerre, bien des espagnols passèrent en France, où ils furent mis dans des camps. Et puis, petit à petit, ils allèrent travailler dans des fermes.
Mais avant d'aller plus loin, revenons quelques années plus tôt.
J'ai vécu tout seul après l'émancipation que ma mère m'avait accordée. Dans mon travail, j'ai visité pratiquement tous les quartiers de Paris et de nombreux théâtres. Au Théâtre Antoine se produisaient des comédiens prestigieux tels que Louis Jouvet, Victor Boucher, Victor Francen et Firmin Gémier. Puis ce furent les Opérettes Marseillaises avec Alibert et « le Pays du Sourire » avec Willy Tunis à la Gaîté Lyrique, en°1933. J'allais aussi à l'Opéra Comique, où il y avait de nouvelles pièces chaque semaine en saison d'hiver. Je vis « la Tosca », « Paillasse », « les contes d'Hoffmann », « Carmen », « Lacmé », « Mireille », « Manon » et « la Bohème », avec les plus grands ténors ou barytons de l'époque. J'eus la chance de voir Martha Egget et Jean Kiepura en 1938 dans l’opéra « La vie de bohème ». C'était formidable ! A l'Opéra, je vis Georges Till dans « Lohengrin » et « le vaisseau fantôme ».
Le cinéma ne me laissait pas indifférent non plus. J'y allais très souvent le lundi. En ce temps là, il y avait deux films par séance, plus les actualités. Dans certaines salles également, il y avait souvent des attractions (à l'ABC par exemple). Et puis, enµ1937, ce furent les premiers films en couleur : « La fille du bois maudit » avec Fred Mac Murray, « la baie du destin » avec Annabella et Henry Fonda, « la vallée des géants », « les forêts américaines » et « Ramona », avec Loretta Young et Don Ameche. Il y en eut d'autres, bien sûr.
Souvent, le lundi matin, j’allais visiter les musées (du Louvre, des Arts et Métiers ou de l'Orangerie) ainsi que la présentation des Automobiles qui avait lieu au Grand Palais. Enfin, il y avait beaucoup de choses à voir dans la Capitale.
C'est vers 1935 que je vis mon père pour la première fois, ainsi que mon frère aîné, Edouard, qui avait dix ans de plus que moi. Tous les deux vivaient loin de Paris : mon père à Etampes, où il travaillait comme jardinier, mon frère à Epinay-sur-Orge. Il était marié et avait un petit garçon. Il travaillait dans la grande blanchisserie de Grenelle, qui s'occupait de tout le linge des hôtels et de certains commerces (tels que les tabliers de bouchers). Je crois qu'elle existe toujours. Je voyais aussi souvent mon autre frère, Paul, et ma soeur Marthe.
Marthe était mariée et avait deux petites filles. Hélas, un jour, elle partit de chez elle en abandonnant son mari et ses enfants. A cette époque, ils habitaient au Pré-Saint-Gervais. Son mari, qui s'appelait Paul, mit ses filles en pension et déménagea. Je ne le revis jamais. Quant à ma soeur, je la revis un an plus tard dans un restaurant où elle étais serveuse. Elle s'était remariée avec un cheminot, qui conduisait une locomotive électrique à la Gare d'Austerlitz, entre Paris et Orléans. Je fus reçu chez eux. Ils habitaient rue Mouffetard, tout près de la maison où j'étais né, et ils avaient déjà un petit garçon.
Dans ces années là, je fis bien des quartiers de Paris, car je changeais très souvent de place. C'était le seul moyen d'apprendre le métier.
A cette époque, suivant les saisons, il y avait dans la Capitale bien des manifestations, qui commençaient au printemps par la « Foire aux Jambons » de la Bastille, boulevard Voltaire. A Pâques démarrait la « Foire du Trône » à la Nation. Elle s’étendait du Cours de Vincennes au boulevard Voltaire, jusqu'à la place du même nom. Deux fois l'an, sur les boulevards intérieurs, de la place d'Anvers jusqu'à la place de Clichy, on retrouvait les mêmes manèges et les mêmes attractions qu'à la « Foire du Trône », pendant environ trois semaines / un mois. Le reste du temps, l'été, nous retrouvions sur ces emplacements le père La Boulange, le roi de la pince. Il prenait un poids de vingt kilos en fonte par le petit côté. Il avait avec lui un jeune athlète qui soulevait des charges phénoménales. On voyait aussi l'avaleur de sabres, le briseur de chaînes et le souffleur de feu. Sur les Grands Boulevards, il y avait beaucoup de chanteurs, ce qui m'a permis d'apprendre bien des chansons.
En 1937, il y eut l'Exposition Universelle. J'étais blessé à ce moment là et je ne devais pas travailler pas pendant quinze jours. Aussi, j'en ai profité pour visiter presque tous les pavillons avec une carte permanente. Il y avait une chose curieuse : les deux bâtiments allemand et russe étaient l'un en face de l'autre. Sur le pavillon nazi, il y avait un aigle tenant une croix gammée. Sur celui de l'URSS, il y avait deux ouvriers, l'un tenant une faucille et l'autre un marteau. Dans,les stands allemands, ce n’était que de la propagande National-socialiste. Par contre, dans ceux de l'URSS, il y avait une carte représentant les états toute en pierres précieuses, des manteaux de fourrures de toute beauté et aussi des tracteurs assez grands. Je n'en ai pas eu trop de mes deux semaines de convalescence pour visiter l’Exposition. Il y avait aussi des attractions foraines, mais elles étaient assez chères. Je n'ai pas pu les faire toutes.
Puis j'ai repris mon travail, rue Lecourbe, jusqu'au mois de mars 1938. Ensuite, j'ai travaillé rue des Rosiers, dans une boucherie juive, puis dans une autre encore près du Carreau du Temple. Je suis resté environ quatre mois dans chacune.
Dans le début de l'hiver 1938-1939, je me suis trouvé sans travail et, comme il neigeait, le Chômage m'a envoyé ramasser la neige pendant dix jours. Il fallait y aller sous peine de perdre l'allocation. On devrait en faire autant aujourd’hui pour ne pas laisser les gens à ne rien faire. C'est démoralisant.
J'ai retrouvé du travail rue Montmartre, près des Halles, dans une boucherie demi-gros et j'y suis resté jusqu'à mon départ pour l'armée.
C'est au Noël de 1938 que je rencontrai, chez un copain Simon Verdin, celle qui, plus tard, devait devenir ma femme. Elle aimait la danse, moi pas tellement. Aussi je l'emmenais au cinéma ou au Théâtre du Châtelet, où nous avons vu André Bauge dans « Nina Rosa ». Elle s'appelait Julienne et travaillait chez le Docteur Spector, rue d’Aviron. Puis elle me quitta, car une cartomancienne lui avait dit qu'elle rencontrerait l'Homme de sa vie habillé en bleu. Et puis elle s'aperçut qu'un boucher avait une veste bleue ou une blouse de la même couleur. Comme j'allais souvent chez mon copain, nous nous sommes retrouvés et sommes de nouveau sortis ensemble pendant toute cette année 1939, jusqu'au mois de septembre, date de la déclaration de guerre. Paris était la « ville lumière » et, le soir, nous allions sur les Grands Boulevards ou aux Champs-Elysées. Mais, à partir du 4 septembre, tout s'éteignit et la ville devint sombre, à part les enseignes de cinéma ou de théâtre.
Pour réaliser l'Anschluss, les Allemands, qui avaient occupé la Ruhr et la Rhénanie, envahirent l'Autriche. Puis le Chancelier Hitler réclama les territoires des Sudettes, qui se trouvaient en Tchécoslovaquie. La France et l'Angleterre n'étaient pas d'accord. Aussi, les deux Premiers Ministres de l'époque, Daladier pour la France et Chamberlain pour l'Angleterre, allèrent à Mun}ch pour en discuter avec Hitler. Mais déjà, on sentait que la paix était en danger. D'ailleurs, le Gouvernement avait retenu sous les drapeaux tous les soldats qui devaient rentrer chez eux après leur temps.
Les deux Ministres ont tout accepté, ce qui donna un peu de répit. Mais au 1er!septembre 1939, les armées allemandes envahirent la Pologne car ils réclamaient depuis longtemps le couloir de Dantzig, que les accords de l'Armistice de 1918 avaient octroyé à la Pologne. De son côté, l'URSS, pour se protéger, dénonça les accords qu’elle avait avec la France et l'Angleterre, envahit la Pologne, et signa un traité de non-agression avec l'Allemagne. L'Angleterre et la France, qui avaient des accords de protection avec la Pologne, déclarèrent la guerre à l'Allemagne le 4 septembre 1939.
A cette époque, j'avais vingt-et-un ans. Les gendarmes m'ont retrouvé et j'ai passé mon conseil de révision en octobre.
Julienne et moi avions décidé de nous marier avant mon départ pour l'armée. Cela eut lieu le 27 novembre 1939. Je ne suis resté avec elle qu’un jour et demi car, le 28, je devais partir faire mes classes au camp d'Avord, près de Bourges. J'ai eu deux permissions, que je passai auprès de ma femme : une de quarante-huit heures à Noël et une de huit jours, dite « de détente », au mois de mars.
* * *
1939 - 1940 : le début de la guerre
Début avril, avec le bataillon, nous sommes partis au front à Thénorgues, à la frontière luxembourgeoise. Nous avons voyagé deux jours dans les wagons à bestiaux, en mangeant des boîtes de singe. Quand nous sommes arrivés dans le secteur qui nous était alloué, j'avais une fluxion dentaire. Je ne sais si c'était à cause du froid ou des conserves. Pour me soigner, je fus envoyé à l'Hôpital de Vouziers, où l'on m'arracha la dent malade sans anesthésie. Comme c'était une molaire, j'ai cru que l'on m'arrachait la tête. Mais en fait ils avaient raison, car dix minutes plus tard je n'avais plus mal. Par mesure de sécurité, je suis resté huit jours à l'hôpital.
J'ai été envoyé ensuite au centre de Régiment, le 213e d'Infanterie, à Hannogne-Saint-Martin. J'ai retrouvé mon frère Edouard, qui lui était à Donchery, au dessus de Sedan, à cinq kilomètres de là où j'étais. Nous nous sommes vus plusieurs fois. Au Centre, ils ne savaient pas quoi faire de moi. Finalement, comme j'étais boucher dans le civil, ils m'ont gardé dans ce Régiment au lieu de me renvoyer dans mon unité. Je fus versé à la cantine.
Ce Régiment n’était composé que de territoriaux, c'est-à-dire d’hommes de plus de trente ans. Etant le plus jeune, je me tapais toutes les corvées. Cela dura jusqu'au 10 mai, date à laquelle les Allemands nous ont attaqués. Le 9 au soir, Radio-Stuttgart diffusa un avertissement : « 55 Division, attention! ». Cette Division était la nôtre. Elle comprenait les 331e, 213e et 147e Régiments d'Infanterie.
Le 10 mai au matin, les chars du Général Guderian sont passés à l'attaque en traversant le Luxembourg et le sud de la Belgique, là où la Ligne Maginot n'existait pas. Il y avait seulement des tranchées, comme pendant la guerre 14-18. L'invasion eut lieu face à Sedan, au même endroit qu’en 1870 et 1914. Une fois de plus, la ligne Maginot n’a servi à rien... Face aux tanks allemands, qui étaient très modernes, nous n'avions que des chars Renault de la dernière guerre, qui n'ont pas pesé très lourd. D'autre part, les canons anti-chars de 37 étaient ravitaillés avec des obus de 25 millimètres, et inversement. Les ponts sur la Meuse avaient été minés. Mais quelques jours avant l'attaque, les amorces avaient été enlevées pour être remplacées, ce qui n'a pas été fait. Il faut croire que tout avait été prévu pour que les Allemands ne trouvent pas une trop grande résistance...
Les pertes de la Division furent impressionnantes : plus de soixante pour cent, entre les morts, les blessés et les prisonniers. Mon frère Edouard eut un bras arraché par un éclat d'obus. Il fut transporté à l'Hôpital de Sedan, où il est mort, faute de soins, car tous les officiers du service médical étaient partis. Il ne restait que des infirmiers.
Pour nous, avec notre roulante, ce fut la grande fuite. Nos avons traversé Vouziers sous les bombardements des Messerschmitts et des Heinkels. Des avions français, dans,le ciel , il n'y en avait pas. Comment je m’en suis sorti, je ne le sais pas encore aujourd’hui...
Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans une forêt près de Verdun, où, après quelques jours, nous avons été réformés dans une unité de combat de la Division. On fit un régiment, le 127e, et là encore j'ai eu de la chance, car je fus versé dans la distribution de viande aux différentes Compagnies. Nous allions chercher la viande dans les abattoirs et nous la découpions dans un4camion. Je n’avais toujours pas vu d’Allemands...
Cela dura jusqu'au 14 juin, où nous avons été encerclés à Montmirail. Nous avons eu juste le temps de nous sauver. Dans nos camions, nous avons été bombardés et mitraillés plusieurs fois par les Stukas, qui ne faisaient aucune différence entre les militaires et les populations fuyant devant l’ennemi. Il y eut bien des morts chez ces pauvres gens. Quant à nous, nous eûmes quelques blessés. Avec un copain, nous avons réussi à en sauver deux. Nous les avons aidés à quitter leur camion qui brûlait, car ils n’y arrivaient pas. Nous avons pu nous échapper tant bien que mal.
Et puis le 15, dans le début de l'après-midi, nous avons été faits prisonniers à quelques kilomètres d'Arcis-sur-Aube. Nous étions encerglés dans cette poche, à cent vingt kilomètres de Paris, depuis déjà quelques jours. Aussi, nous nous sommes retrouvés près de dix mille en quelques heures. Nous avons marché jusqu'à Romilly-sur-Seine, où nous sommes arrivés vers 23 h. Sur place, il y avait beaucoup de gens qui étaient couchés. Je me suis laissé tomber et j’ai laissé les autres continuer leur route. Comme j'étais habillé en boucher, les Allemands qui nous gardaient m'ont laissé tranquille.
Quand je me suis réveillé le matin, au petit jour, j’ai vu quelques personnes qui sortaient d'une boulangerie avec du pain. J'ai fait comme eux et j'ai pris un gros pain de quatre livres. Mais, en sortant, je me suis fait ramasser par une patrouille. Quand je pense que j'aurais pu me cacher dans une maison deux ou trois jours, car juste après c'était l'Armistice... Enfin ! Il ne"faut pas trop s'apitoyer. J'ai retrouvé mes copains et j'ai partagé mon pain avec eux.
Nous sommes repartis vers 10 h et avons marché jusqu'à Nogent-sur-Seine. Le soir, il y avait une distribution de nourriture, mais nous étions trop nombreux. Aussi, beaucoup d'entre nous n'étaient pas servis.0Notre marche dura sept jours. Nous avons mangé un peu de tout : des betteraves, que j'allais arracher, ou des pommes de terre grosses comme des billes. Nous sommes passés par Esternay, Château-Thierry, Soissons et Laon.
Là, au matin, les Allemands demandèrent quels étaient ceux qui voulaient travailler. Comme nous étions près de la sortie du camp, une corvée de trente prisonniers, dont je faisais partie, a été prise pour aller réparer les voies ferrées du centre de triage, qui avaient été bombardées. Il fallait aussi faire des panneaux de signalisation pour la circulation des trains. Les cheminots allemands avaient besoin pour cela de peintres en lettre. J'ai levé la main, et six d'entre nous ont été pris. Dans l'atelier, j'ai demandé quels étaient ceux qui savaient peindre. Il y en avait deux, alors ce fut facile. Ils faisaient l'épure des lettres et nous nous les remplissions. Comme nous travaillions le midi, nous avions à manger, ce qui n'était pas si mal. Au bout de quelques jours, les panneaux étant finis, il fallut bien aller réparer les voies. Ce n'était pas aussi bon. Mais déjà je pensais à m'évader...
Un jour, nous étions deux à accompagner un ouvrier allemand des voies ferrées. Il n'était pas armé et nous avions tous les deux une barre à mine. Nous pouvions l'assommer et nous sauver. Mais c'était un ancien prisonnier de la guerre 14-18, qui était très gentil, car il partageait sa gamelle et son tabac avec nous. Avec lui, nous redressions les aiguillages sur plusieurs kilomèures, ce qui nous emmena à un petit village pas très loin du$camp où nous étions internés. Il y avait une épicerie et nous avons ramené un peu de ravitaillement. Alors, les copains me dirent : « toi qui es débrouillard, on te donne de l'argent et tu nous ramènes à manger ».
Après avoir cherché dans tous les endroits de la gare, j'ai trouvé un bleu de travail, une vieille casquette, et, plusieurs jours de suite, je suis parti sur les voies,0jusqu’à ce village. Je ramenais tout ce que je pouvais trouver. Et puis je me suis dit : « tu fais trois kilomètres, tu peux bien faire le reste et rentrer à Paris ». J'en ai parlé à plusieurs de mes camarades. Ils croyaient tous être libérés, car les Allemands avaient dit : « guerre finie, vous libérés ». Mais nous voyions chaque jour des trains entiers pleins de prisonniers qui partaient pour l'Allemagne. Et pourtant mes copains étaient optimistes. Moi, je ne l’étais pas. J'ai réussi à en trouver un qui ne croyait pas non plus à la libération des prisonniers.
J'avais remarqué que l'officier du camp et celui des travaux à la gare s'en allaient au bureau du camp pour marquer « donné : trente hommes, pris : trente hommes ». Nous restions alors tout seuls pendant quelques minutes. En dehors du camp, il y avait deux baraquements qui servaient au coiffeur et au cordonnier. Mon plan était simple : sortir avec les autres, mais au lieu de me mettre dans les rangs, me cacher derrière les baraques. C’est ce que je fis. Les Allemands ont compté : il n'y avait que vingt-huit hommes. Ils en prirent donc deux de plus et allèrent, comme d'habitude, marquer au bureau. Alors nous nous sommes glissés dans le groupe avec les autres. Il y eut quelques murmures que je fis taire en leur disant d'en faire autant le lendemain ou un autre jour, car, de toute façon, ils partaient et rentraient à trente.
A la gare, en plus de mon bleu de travail, j'en avais planqué un deuxième. Mon copain et moi, nous nous sommes changés. Avec chacun une musette sur l'épaule et une casquette sur la tête, nous étions parés. Après avoir inspecté les alentours, nous sommes partis sur les voies ferrées et, pendant huit kilomètres, nous avons marché à toute allure. Puis, après un détour pour éviter une Kommandantur que l'épicerie m'avait signalée, nous avons trouvé la route de Soissons. Nous avons marché très vive. La route était pratiquement déserte.
Quand nous sommes arrivés à Soissons, il était plus de 2 h. Nous n'avions pas beaucoup d'argent mais nous avons réussi à manger un peu dans un restaurant. Dans cet établissement, nous avons appris que le pont sur l'Aisne était démoli et remplacé par un pont de bois, gardé de chaque côté par un soldat allemand. Que faire ? Il(n'était pas question de traverser à la nage. En y réfléchissant, j’ai pensé que nous pourrions prétendre que nous étions des employés des chemins de fers. C’était tout à fait plausible, car la gare était(de l'autre coté de la rivière et nous étions vêtus en cheminots. C'était la seule chose à faire et il fallait tenter le coup. J'ai dit à mon copain : « en passant sur le pont, il faut saluer les soldats ». Nous l'avons fait et ils nous ont rendu notre salut. Et, comme cela, nous sommes passés sans coup férir.
Nous avons marché encore quelques kilomètres pour sortir de la ville, avant de faire halte dans une ferme abandonnée. Nous étions très fatigués. Il y avait pas mal de poulets. Aussi, nous en avons tué un, que nous avons plumé et cuit sur un feu de bois, avec quelques pommes de terres à l'eau. Nous avons fait là notre meilleur repas.
Après s'être reposés toute la nuit, nous avons repris la route vers Villers-Cotterêts. Il y avait quelques voitures qui repartaient de Soissons, car elle ne pouvaient pas repartir dans l'est ou le nord, qui étaient bloqués par les Allemands comme « Zone Rouge ». Nous avons fait signe plusieurs fois mais personne ne s’est arrêté.
Entre Soissons et Villers-Cotterêts, il y avait à un endroit une grande côte très longue et une des voiture n’arrivait pas à la monter. Nous, nous l'avons poussée, et, une fois arrivés en haut, les gens nous ont pris avec eux. Ils allaient à Lagny, à trente kilomètres de Paris. Nous ne leur avons pas caché que nous étions des prisonniers évadés, car il y avait souvent des contrôles de la Gendarmerie allemande sur les routes. Ces gens nous ont prévenu que s’ils voyaient quelque chose de loin, ils se verraient dans l'obligation de nous abandonner, ce qui était juste. Cela s'est produit vingt-deux kilomètres après Villers-Cotterêts.
Nous nous sommes cachés un moment et, quand la route a été libre, nous nous sommes orientés. Nous ne pouvions pas retourner en arrière. Par une petite route, nous avons pris la direction de Nanteuil-le-Haudouin, qui se trouvait à vingt-cinq kilomètres. Nous y sommes arrivés en début d'après-midi. A la gare, on nous apprit qu'un train partait pour Paris vers 16 h. Avec les quelques francs qui nous restaient, nous$avons pris chacun un billet. Après cela, nous avions encore trois francs, assez pour un camembert et un morceau de pain, que nous sommes allés manger dans la gare en attendant le train. C’était déjà le repas de la liberté...
Dès que nous avons été dans le wagon et que nous avons senti le train démarrer, ce fut une grande joie. Le voyage dura assez longtemps, car on s'arrêtait souvent. Enfin, nous sommes arrivés à Paris, Gare du Nord. On nous avait dit que nous serions repris car il y avait(une surveillance dans les gares. Mais je connaissais bien la Capitale, et je savais que je pouvais nous en sortir. J'ai interrogé un employé qui se trouvait là. Il m'a répondu que nous pouvions passer par la porte, tout simplement, car il n'y avait pas de contrôle. C’est"ce que nous fîmes illico.
Dès la sortie de la gare, je suis tombé sur mon beau-frère, qui était Sergent de la ville et$qui faisait la circulation. Il fut très étonné car il me savait prisonnier. Puis, avec mon camarade, nous sommes partis vers là où habitait ma femme, rue de Constantinople, derrière la Gare Saint-Lazare. Nous y sommes allés à pied car nous n'avions plus un sou et que je ne voulais rien demander à mon beauf.
Trois quarts d'heure après, j'étais chez nous, ou plutôt chez mon épouse, car elle avait une chambre de bonne au sixième étage. Elle était folle de joie. Nous avons mangé puis nous nous sommes couchés, mon copain et moi par terre, car il n’y avait qu’un0petit lit. Mon épouse, le lendemain, a donné un peu d’argent à mon copain qui repartait pour la Savoie. Il devait nous écrire mais je n’ai pas eu de ses nouvelles... Quant à moi, je suis allé prendre un bain, puis j’ai été chez le coiffeur.
Julienne ne travaillait plus chez le Docteur Spector. Vu ses origines, il était parti dès le début de la guerre, car il avait peur des Allemands. Il avait bign raison... Elle avait cherché une autre place et l’avait trouvée, chez Madame Etlinger, rue de Constantinople. Mais Madame Etlinger l'avait mise à la porte sans la payer au moment de l'arrivée des Allemands à Paris. Dès mon retour, comme je l’ai fait deux fois pour moi, je l'ai attaquée aux Prud'hommes et nous avons eu gain de cause. En plus, comme ma femme était enceinte, nous eûmes droit à un dédommagement. Cela se passait à la fin août 1940.
* * *
1940 - 1944 : l'Occupation
Le 2 septembre, je suis descendu aux Halles pour trouver du travail, ce que je faksais toujours avant la guerre. Mais dans la boucherie, il n'y fallait pas compter. Les boutiques étaient presque toutes fermées par manque de viande. Heureusement, c'était la pleine période des huîtres et je fus embauché pour la livraison rue du Coq-Héron, aux Parcs de la Côte Rouge, dont la spécialité était les huîtres plates Belon.
C’était une maison importante. Nous étions quatre livreurs et avions comme clientèle les Grands Restaurants de Paris, plus tous les écaillers. Cela se vendait bien, car les Belons de la Côte Rouge étaient renommées. Et puis les caissettes de cent Belons, comme celles que nous avions, étaient très recherchées au moment des fêtes de fin d'année. Nous vendions également des Fines de Claire, des Marennes d'Oléron et des Plates de Marennes. Ces dernières sont des Belons que l’on met dans des parc spéciaux pour qu’elles verdissent. Elles sont très appréciées des connaisseurs.
Vers le mois d'octobre, j'ai voulu me faire démobiliser à la Gendarmerie Militaire. Ils m'ont dit de me présenter à la Kommandantur allemande. Comme j'étais évadé, j'ai demandé l'adresse mais je n'y suis jamais allé. Mais malheureusement, sans feuille de démobilisation, je n'avais pas de carte de rationnement. Après avoir réfléchi, j'ai décidé d’aller voir le Commissaire du dix-neuvième car, entre temps, nous avions déménagé. Nous nous sommes d'abord installés à l'hôtel rue Piat dans le vingtième, où nous sommes restés un mois. Puis nos avons emménagé dans une chambre au sixième étage, rue des$Bois, dans le dix-neuvième, près de la place des Fêtes.
Donc, pour avoir des papiers, j'ai parlé au Commissaire du dix-neuvième et je lui ai raconté mon histoire. Il me dit : « vous avez pas peur vous ! Mais revenez me voir après-demain ». J’y retournai deux jours plus$tard mais je n’étais pas très fier. En fait, tout s’est très bien passé. Il avait tout préparé et j’ai pu avoir les papiers nécessaires pour aller chercher mes cartes d’alimentation. Je lui en garde une très grande reconnaissance.
Cet homme était un résistant de première heure. Il le prouva d’ailleurs par la suite. Lorsque les Allemands ordonnèrent la rafle des juifs dans le dix-neuvième, il fit prévenir tous ceux qu’il connaissait par des agents sûrs qui étaient avec lui. Il fut arrêté quelques mois plus tard et déporté. Je viens ici saluer sa mémoire.
A cette époque, en conséquence de l'Armistice signé le 17 juin 1940 par le Maréchal Pétain, une grande partie de la France était passée aux mains des Allemands. Le pays était partagé en0deux zones : la zone occupée par l'Allemagne et%la zone libre, devenue Etat français, dirigé par le Maréchal Pétain. Cette guerre avait fait plus de cent vingt mille morts et deux millions de prisonniers. Le pays étiit complètement désorganisé. Dans les campagnes, les fermes étaient abandonnées par l'exode des populations, les blés n'étaient pas coupés et les animaux pas soignés. En plus, les gens qui se sauvaient sur les routes étaient mitraillés et bombardés, non seulement par l'aviation allemande mais aussi par l'aviation italienne. En effet, les Italiens avaient déclaré la guerre à la France le 10 juin 1940 et le Duce, Mussolini, réclamait la Corse, Nice et la Savoye. Les Italiens avaient attendu que la France soit abattue pour l'attaquer. Ils se heurtèrent quand même, dans les Alpes, à la résistance féroce des Chasseurs Alpins. Mais ils réussirent à obtenir, malgré tout, grâce à l'Armistice, l'occupation d'une partie de la Côte d'Azur. Ceci était un point à préciser.
Je reviens maintenant à notre vie à Paris, où/ pendant quelques mois,0nous avons trouvé encore un peu à manger. Dans la chambre que nous occupions, et qui n'était pas très grande, nous avions réussi à mettve un lit, une table et deux chaises. S'il venait une ou deux personnes, on ouvrait la porte pour agrandir et deux d’entre nous mangeaient dehors. C'était très amusant ! Enfin, nous étions heureux. La paye n'était pas très grosse mais je faisais de bons pourboires, ce qui compensait.
Le 8 décembre 1940 naquit Michel, notre fils, un beau et gros bébé, qui poussait comme un0champignon. Son arrivée réduisit encore un peu la pièce où/nous vivions, car un berceau, sans être grand, ça prend de la place. Mais le travail que je faisais comme livreur s'arrêta à la fin du mois d'avril car les$huîtres ne se vendaient pas les mois sans « r ». Donc, au mois de mai, je n'avais plus de travail. J'en trouvai un autre au Comptoir des Bouchons, rue Marcadet, toujours dans la livraison. Mais, au lieu de livrer avec un triporteur, c'était avec un vélo et une remorque. Je livrais les restaurants et les drogueries dans tout Paris et même assez loin dans la banlieue.
Vers le mois de mars 1941, nous avons eu la chance de trouver, au 203 rue de Belleville, un petit deux-pièces au troisième étige, avec une cuisine d'un mètre cinquante. Pour monter au troisième, c'était aussi raide qu'une échelle. Il n'y avait pas de WC et il fallait descendre dans la cour. Mais enfin, c'était plus grand.
L'hiver 1941-1942 fut très rude et la pénurie de nourriture et de charbon était de plus en plus grande, car les Allemands réquisitionnaient les denrées pour nourrir les troupes d'occupation. Il fallait faire la queue pour presque tout : rutabagas, carottes, navets, etc. Quant aux pommes de terre, c'était rare. Pour la viande, nous étions limités à quatre-vingt dix grammes avec os par personne et par semaine. L'huile, le beurre et le sucre étaient contingentés. Quant au café, c’était(de l'orge. Nous avions toujours faim et froid. Cet hiver là, ma femme et mon fils âgé d’un an restaient le plus longtemps possible au lit sous les couvertures pour avoir chaud. Et moi je continuais à livrer mes bouchons, hélas, de plus en plus loin. Et comme je ne mangeais pas toujours à ma faim, c’était très difficile. En plus, au mois de février, toutes les routes étaient verglacées et, bien des fois, je ne pus faire les livraisons. Avec les quelques pourboires que je recevais, j'achetais, pour apaiser mon estomac, des bretzels ou des gressins, qui étaient en vente libre. Mais comme ils étaient très durs, je me suis cassé trois dents.
Enfin le printemps est revenu. Julienne était de nouveau enceinte. Comme nous trouvions de moins en moins de nourriture, elle allait, avec Michel, au Centre Marguerite Marie, comme beaucoup de femmes dans son état. Elle avait droit à une soupe et un peu de pâtes. C'était là qu'elle devait accoucher, le 18 juillet 1942, d'une fille qui se prénomma « Monique ».
Moi, pendant ce temps, je travaillais depuis le mois d'avril, tous les samedis et les dimanches, avec un copain qui possédait un tandem. Il avait construit un taxi qui s'accrochait au tandem et nous emmenions des gens aux courses à Longchamps ou dans Paris. Cela me permit de gagner un peu plus d'argent et d’améliorer notre vie.
Dans ces années là, j'avais quelques copains que j’avais connus à la boucherie : Albert Fargeas, Louis Laforge et Simon Verdin (qui devint mon beau-frère). Pendant l'occupation, je rencontrai André Tessier. Avec lui, après la fin de 1942, je fis des livraisons dans la journée pour plusieurs maisons (quand celle qui m'employait pour la livraison de bouchons n'eut plus de travail). Le soir, nous transportions les gens dans notre taxi d'une boite de nuit à l'autre, jusqu’à 3 ou 4 h du matin. André avait réussi à avoir un Ausweis qui nous permettait de pouvoir circuler la nuit.
Cela dura jusqu'au mois de février 1943, où nous reçûmes$l’ordre de nous rendre à la Gare de l’Est, avec une couverture et deux jours de vivres. C’était un ordre de départ pour le STO (Service de Travail Obligatoire) en Allemagne.
Depuis la poignée de mains du Maréchal Pétain avec Hitler à Montoire, des centaines de milliers de français partaient pour le STO dans les usines allemandes. C’était soit disant pour remplacer les prisonniers français. Effectivement quelques soldats revinrent. Il furent copieusement photographiés pour la Propagande. En fait, il faut dire que les Allemands, en 1940, avaient essayé d’envahir la Grande-Bretagne et avaient échoué. Depuis, ils la bombardaient pratiquement toutes les nuits. En 1941, ils avaient également attaqué l’URSS, sur trois fronts : vers Léningrad, pour s’emparer des ports de la Mer Baltique, vers Moscou et vers Stalingrad. En conséquence, les usines allemandes avaient été vidées de presque tous leurs ouvriers et il fallait les remplacer. Beaucoup de personnes sont parties construire des Blockhaus pour ce qui s’est appelé « le mur de l’Atlantique ».
Dès le lendemain du jour où nous avons reçu l’ordre de départ pour le STO, mon copain partit pour l’Allemagne. Moi, je pris le train pour Crépis-en-Valois, et je me retrouvai dans l’Oise, à Cuvergnon, chez le père et la belle-mère de Julienne. Ils me firent engager dans la ferme où ils travaillaient, qui s’étendait sur un grand champ de deux cents hectares de terre. Ils y faisaient pousser du blé, des betteraves, des pommes de terre et quelques autres cultures.
Quelques jours après mon arrivée, le berger, qui possédait une vieille maison, eut la gentillesse de me la prêter. Il me fallut plusieurs jours pour la remettre en état (nettoyage à la chaux et pose de papiers disparates, donnés par l'un ou l'autre des voisins). Ce n'était pas très beau, mais enfin c'était propre. Il y avait une vieille cuisinière à bois, dont je dus refaire le four qui était brisé, avec une grosse tôle que j'eus bien du mal à découper, à encastrer et à colmater avec de la terre réfractaire. Ce fut beaucoup de travail, mais avec de la ténacité, j'y suis arrivé. Quand tout fut prêt, j'ai fait venir Julienne et les deux enfants. Nous avons vécu là jusqu'à la fin de l'occupation de la région parisienne.
Le fermier m’avait cédé dix ares de terrain pour faire pousser des légumes. Par ailleurs, beaucoup d’ouvriers m’avaient donné des graines, des semis de pommes de terre, des plants de poireaux, enfin, de quoi survivre. Les premiers mois, ce fut difficile, car il fallait attendre septembre pour récolter. Nous étions obligés d’acheter tout ce dont nous avions besoin : du blé, pour faire de la farine, des légumes, etc. Une fois par semaine, nous recevions trois ou quatre cents grammes de viande pour le travail que nous faisions de 6 h 30 le matin à 6 h 30 le soir. Ce n’était pas beaucoup et je suis souvent parti travailler l’après-midi avec seulement une purée de légumes et un morceau de pain dans le ventre. Mais au moins j’étais resté en France...
Le printemps et l’été furent assez beaux. Julienne était de nouveau enceinte. Grâce aux légumes que j’avais pu faire pousser, notre condition de vie s’améliora.
Et puis ce fut l’hiver, assez rude, pour nous mais aussi pour les Allemands. Ils connurent leur première défaite à Stalingrad, où le Général Von Paulus dut se rendre avec deux cent mille hommes. A Léningrad, les russes tenaient bon, les empêchant d’accéder à la Mer Baltique. Enfin Moscou, au centre de leur invasion, était bien défendu.
En Afrique du Nord eut lieu le débarquement des Alliés. Les Allemands ripostèrent aussitôt en France en envahissant la zone libre. Ils tentèrent de s’emparer de la flotte française qui se trouvait à Toulon mais celle-ci réussit à se saborder à temps. De nombreux français de cette zone se cachèrent alors dans les forêts pour ne pas partir en Allemagne. C’est là que commença vraiment la résistance.
Dans le nord de la France, Doriot avait créé la Légion des Volontaires Françcis, la LVF, qui partait en Allemagne pour soit disant défendre le pays. Dans le sud, Darnand avait créé la Milice, avec les anciens amis du Colonel La Rocque. De nombreux résistants furent arrêtés par la Gestapo allemande, torturés, puis libérés pour enfin être déportés dans les camps de la mort.
A Paris, deux anciens policiers, Bormi et Lafont, avaient implanté une cellule de torture dans un hôtel de la rue de Lauriston. Là, aidés de truands comme Danas, ils rançonnèrent et torturèrent beaucoup de gens, des résistants et d’autres, surtout pour s’emparer de leur fortune. C’étaient d’exécrables bandits, car, après leur avoir arraché les ongles et leur avoir infligé le supplice de la baignoire, ils les livraient aux Allemands, qui les déportaient à Ravensbrück ou à Dachau. Ils en fusillèrent beaucoup au Mont Valérien mais plusieurs moururent dans les prisons, faute de soins. Quelques uns réussirent à s’évader. Ils ne furent pas nombreux. Vers la fin de 1943, la résistance s’amplifia car il y eut beaucoup de parachutages d’armes.
Quant à moi, j’ai continué à travailler dans cette ferme. J’étais persuadé que la guerre ne durerait pas. Ce furent des années difficiles, car je gagnais très peu et tout était cher. Bien sûr, j'avais un bout de terrain que je cultivais, mais je dois avouer que je n'étais pas un bon paysan.
Quand le printemps revint, il y eut de nouvelles semailles. Tous les dimanche matin, j’allais en forêt pour couper du bois, car nous n’avions pas de charbon. C’était très agréable. Je dois dire que j’ai toujours aimé la forêt.
Au mois d'avril 1944, Julienne partit à Villeneuve-le-Roi pour accoucher. Elle se retrouva à l'Hôpital de Juvisy, où, le 9 avril, elle mit au monde un garçon, qu'elle appela « Gérard ». Je suis resté avec Michel et Monique, que je faisais garder par ma belle soeur et mon frère Louis. Eux aussi étaient venus s’installer à la ferme pour ne pas partir au STO en Allemagne.
A cette époque, les Alliés anglais et américains bombardaient tous les points stratégiques. Mails ils se trompaient souvent et cela tombait à côté. Deux jours après la naissance de Gérard, les Américains bombardèrent la gare de Juvisy et les voies de triage. Plusieurs bombes tombèrent près de l'hôpital, cassant toutes les vitres. On n'avait pas pu évacuer les malades, les accouchées et celles qui attendaient cet événement. Ils étaient tous couchés sous les lits. Quand Julienne est revenue, elle avait les nerfs très malades et elle pleurait souvent.
Enfin, le 6 juin, nous apprîmes le débarquement des Alliés à Arromanches et un grand espoir nous envahit. Nous savions que les Allemands reculaient sur presque tous les fronts. Le soir, nous écoutions la radio anglaise, mais nous ne comprenions pas grand chose à tous les messages qui étaient transmis. En plus, le débarquement était très long à sortir de l’étau que les Allemands avaient construit le long des côtes françaises.
Et puis, petit à petit, les Alliés réussirent à desserrer l’étreinte. A la fin du mois de juin, ils avancèrent vers l’intérieur des terres normandes, libérant de nombreuses villes. Mais il fallut attendre la fin du mois d’août pour que le Général Brady autorise le Général Leclerc à venir libérer Paris, qui avait pris les armes. Mais les FFL, les Forces Françaises Libres, avaient très peu de fusils. A la préfecture de Paris, Joliot-Curie fabriqua des bombes de fortune avec des bouteilles, que les résistants lançaient sur les chars allemands.
Le Commandant Allemand Von Choltitz avait reçu l’ordre du Chancelier Hitler de faire sauter tous les édifices importants de Paris, qui étaient minés depuis déjà plusieurs mois. Heureusement, græce au Consul de Suède, dont hélas je ne me souviens pas le nom, Paris fut épargné. En plus, dès l’arrivée des chars du Général Leclerc, les occupants déposèrent les armes. Il y eut encore plusieurs jours de combat dans les rues, car des miliciens s’étaient retranchés un peu partout : sur les toits, dans les caves, sous les tunnels du métro, etc.
Le débarquement dans le midi de la France du Général De Lattre De Tassigny et de son armée précipitèrent les choses. Ils avançaient très vite car il ne rencontraient pas beaucoup de résistance de la part des Allemands. Cependant, beaucoup d’exactions furent commises, en particulier par le groupe « Das Reich », qui massacra toute la population d’Oradour-sur-Glane. Partout où ils passaient et où ils trouvaient du monde, c’était la même chose.
Les Allemands avaient réussi à installer des rampes de lancement dans le nord de la France, qui n’était pas encore libéré. Pendant plusieurs semaines, ils envoyèrent des bombes volantes appelées « V1 » sur Paris et aussi sur Londres. Beaucoup furent abattues par l’aviation, mais quelques unes tombèrent et firent pas mal de dégâts. Ce furent les derniers sursauts de la guerre sur Paris.
Le 29 août, j’ai quitté la ferme où j’avais travaillé un an et demi et je suis rentré à Paris. J’ai marché pendant trente kilomètres environ puis j’ai trouvé un camion qui allait à la Porte de la Villette. Nous étions serrés comme des harengs dans ce camion mais tous tellement heureux. Trois heures plus tard, nous sommes arrivés à Paris. Je suis remonté chez moi à pied car le métro ne fonctionnait pas.
Après une bonne nuit de sommeil, je suis descendu sur les boulevards. J’avais besoin de respirer l’air de Paris qui m’avait tant manqué, car je suis un vieux parisien. C’était quand même risqué, car il y avait toujours des tireurs embusqués un peu partout. Il fallut bien plusieurs jours pour les déloger.
Puis je me suis mis à la recherche d’un travail. J’avais appris qu’on recherchait des terrassiers pour dégager les alentours de Paris, de la Porte de la Chcpelle à la Porte de Clignancourt. Dès le 4 septembre, j’ai réussi à me faire engager chez Petit, une entreprise de pavage et de canalisation. A cette époque, nous étions une trentaine, employés à déblayer les abords des boulevards extérieurs qui avaient été bombardés (une erreur des Américains qui voulaient toucher les voies ferrées). Il y avait beaucoup de travail.
Au mois d'octobre, les treins étant de nouveau en service, je suis allé chercher Julienne et les trois enfants, car je ne pouvais pas les laisser passer l'hiver là bas. Bien sûr la vie ne fut pas rose. La pénurie de nourriture se faisait sentir très durement. On ne trouvait pas grand chose à manger car tout était encore réglementé. Il fallait des tickets pour le pain, le sucre et toute autre marchandise indispensable à la survie.
En plus de mon travail, j'allais livrer du charbon lorsque je rentrais le soir, de 18 h à 20 h. Je n'étais pas payé mais je recevais des pourboires, et puis le bougnat me donnait de la charcuterie et du fromage. Comme j'étais jeune, je ne sentais pas la fatigue. L’hiver 1944-1945 fût très dur. Pour le chauffage, en plus du peu de charbon, je ramenais du bois de démolition tous les soirs.
Et puis j’ai retrouvé mon copain avec qui j’avais fait du vélo-taxi. Comme il n’y avait pas encore de voitures, nous avons recommencé à travailler le samedi soir et le dimanche, ce qui m’a permis d’améliorer notre vie et surtout de manger un peu mieux.
Cela dura jusqu’en 1945. Le 8 mai, ce fut l’Armistice et nous avons poussé un « ouf » de soulagement. Enfin on pouvait respirer. La guerre était finie.
Ce 8 mai 1945, une foule énorme envahit les rues de Paris et tout le monde se mélangea : les GI américains, les soldats français, les soldats anglais et bien sûr tous les gens qui étaient descendus dans la rue pour l’occasion. La foule remonta les Champs-Elyées et les Boulevards. C’était la folie ! Quelle grande émotion !
Le Général de Gaulle et tout le gouvernement étaient à l’Arc de Triomphe. C’était la plus grande liesse que l’on ait pu voir jusque là, plus importante encore que pour l’arrivée du Général de Gaulle à la libération de Paris, qui avait pourtant été un événement. Le lendemain, il y avait encore beaucoup de monde dans la rue...
* * *
De 1945 à aujourd’hui
La paix était enfin arrivée. Elle avait été tant attendue, tant espérée. Nous allions pouvoir reconstruire. Mais avec quoi ? Nous étions dépourvus de tout. Les Allemands avaient dévalisé nos usines et il n’y avait plus de machines-outils. Dans l’entreprise où je travaillais, il y avait un seul camion pour déblayer. Ce n’était pas suffisant. Puis le patron, Monsieur Petit, réussit à racheter deux autres véhicules, ce qui nous permit de faire du travail plus important.
Au début de l’année 1946, de terrassier je passai garçon-paveur. C’était moins dur et, petit à petit, la vie s’améliora. Mais la nourriture était(encore difficile à trouver. Aussi, l’hiver 1946-1947, comme j’avais été nommé Délégué Syndical, je proposai au patron de me prêter un camion pour aller chercher des pommes de terre dans les fermes. Il accepta et nous partîmes de trìs bonne heure. Dès l’après-midi, nous avions distribué mille kilos de pommes de terre, ce qui faisait environ vingt-cinq kinos par personne.
Ce patron était dur mais juste. A chaque fois que je demandais quelque chose, c’était justifié. Il réfléchissait et souvent il acceptait. J’ai pu avoir pour les terrassiers et les garçons-paveur deux heures de prime par journée de travail. Il faut dire que les paveurs travaillaient à tâche et faisaient pratiquement double journée. Nous devions les suivre, ce qui n’était pas normal. J’ai obtenu des baraques de chantier, chose qui n’existcit pas jusque là, ainsi que des bottes pour les ouvriers qui étendaient le goudron sur les pavés.
Par contre, j’ai toujours été contre les grèves politiques qui étaient très à l’honneur à cette époque. Aussi, n’étant pas assez politisé, je fus remplacé en 1946 en tant que Délégué Syndical. Coome le patron voulut supprimer les primes que j’avais eu tant de mal à obtenir, je décidai de partir. Mais il avait beaucoup d’estime pour moi, alors il me proposa une place de chauffeur poids-lourd. C’était une promotion avec un meilleur salaire. Par contre, je me levais plus tôt le matin car le dépôt était assez loin. Il se trouvait à Gennevilliers et, pour m’y rendre, je devais changer deux fois de métro. Ensuite je devais prendre un bus pendant au moins vingt-cinq. J’ai fait ce trajet matin et soir pendant environ un an.
Au mois d'avril 1948, je tentai ma chance comme vendeur de fruits et légumes à mon compte. Cela dura jusqu'au mois de novembre, où je fis une mauvaise affaire en achetant des oranges du Maroc. Il8n'y en avait pas à l'époque. Hélas,0au même moment, on a ou~ert le marché à l'Espagne, et, pour ne pas tout perdre (car j'en avais mille kilos) j’ai dû les vendre à perte. Alors j'ai abandonné.
J'avais comme voisin un juif qui revenait du camp d'internement d’Auschwitz en Allemagne et qui faisait de la confection. Il m'a appris à repasser. Je suis devenu presseur pour pantalon, encore un nouveau métier. Ce ne fut pas très facile. Ce métier, je l’ai exercé plusieurs années dans quelques ateliers, avec des hauts et%des bas. Mais enfin, je gagnais bien ma vie. J'ai fait plusieurs maisons puis j’ai été embauché par deux soeurs. Là, pendant deux ans, j'ai eu pas mal de travail. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai dû encore changer. Je suis cependant resté dans la confection.
J’ai appris le repassage des vêtements féminins, c’est-à-dire des manteaux et des tailleurs. Quand j’ai commencé dans ma première place, le patron, en voyant comment je m’y prenais, m’a demandé si j’exerçais depuis longtemps.0Je lui ai répondu que c’était ma première pièce. Comme il voyait que je voulais travailler, il m’a appris le métier et je l’en remercie.
A cette époque, c’était de la belle confection. Mais ce métier était très saisonnier et il y avait une morte saison. Aussi, il fallait faire plusieurs maisons et travailler beaucoup quand cela marchait. Pour gagner ma vie, et celle de ma famille qui s'était encore agrandie, il me fallut faire jusqu'à trois places par jour. Je partais à 3 ou 4 h du matin et je rentrais à 10 ou 11 h du soir. C'était très difficile. Heureusement, grâce à Julienne qui était très économe, nous arrivions à vivre quand même.
Je m'aperçois que, pendant ces dix ans, je n'ai parlé que de moi. Pourtant ma famille, c’est-à-dire ma femme et mes enfants, a eu bien des ennuis. Notre fils aîné, Michel, était aveugle et, à l'âge de trois ans, il fit une encéphalie qui le handicapa et lui raidit les doigts. Donc, pour apprendre le braille à l'école spéciale de Saint-Mandé, ce fut très difficile. Il y est resté sept ans, de l’âge de six ans à l’âge de treize ans, mais ils n'ont pas pu le garder plus longtemps. Il a fait bien des bêtises dans les années qui ont suivi.
Quand à Monique et Gérard, eux, ils allaient très bien et nous n'eûmes pas trop de soucis avec eux. En 1951, Julienne était de nouveau enceinte et devait accoucher au mois de septembre. Pour la première fois cette année là, nous sommes partis en vacances à la mer, à Ault-Onival. Nous y avons rencon|ré des gens charmants. Après le bain, pour nous réchauffer, nous jouions au Jocary et nous nous promenions sur les dunes. C’est à l’Hôpital d’Eu que Julienne a accouché d'une petite fille, le 28 août, que l'on a appelée « Christine ». Je suis donc rentré à Paris le 30 avec seulement Monique et Gérard.
Quelques années auparavant, nous avions fait unu demande de HLM. En rentrant de vacances, je trouvai une acceptation, c’est-à-dire un avis nous demandant de nous présenter pour un logement HLM sur la commune de Pantin. Hélas, comme cet avis était arrivé depuis quinze jours et que nous n’avions pas répondu, c'était trop tard quand je me suis présenté. Je fus très déçu. Mais comme c'était une première distribution, et que la Cité Jardin n'était pas terminée, nous fûmes inscrits pour la seconde répartition.
Malgré le désaccord de l'hôpital, Julienne est rentrée trois jours plus tard. C'est un ami qui l'a ramenée dans sa deux-chevaux. Elle n'était pas très forte. Aussi, la femme de cet ami est venue souvent l'aider à la maison.
Cette même année, au mois de décembre, nous eûm}s ce logement que nous attendions depuis si longtemps. A ce moment là, le travail était au plus bas. Aussi, pour le Noël, ce fut difficile. Mais l'appartement était grand et nous avions très peu de meubles. Alors les enfants jouaient à cache-cache dans les placards. Et puis, au printemps, le trevail reprit, et, ma foi, cela alla beaucoup mieux. J'avais deux bonnes places.
En 1953, Julienne mit au monde un garçon qui se prénomma « Jean-Jacques ». Nous avions donc cinq enfants, alors je dus trouver encore plus de travail pour faire vivre toute cette petite famille, que je ne voyais vraiment que le dimanche.
J'eus la chance de tomber sur une grande maison de confection où il y avait peu de morte saison. C’était chez Monsieur Monas, rue Notre-Dame de Nazareth, où je travaillais toujours pendant la journée. Mais, par mesure de sécurité, j'ai toujours gardé un de mes meilleurs ateliers chez Monsieur Simon, rue Saint-Denis, où j'avais quelques pièces à repasser par jour. Cela dura plusieurs années, et la vie s'améliora.
Ce furent des années plus faciles et nous partîmes en vacances tous les ans. Avec quatre enfants et tous les bagages, cela nous donnait beaucoup de mal. Pour aller à Batz-sur-mer ou aux Sables d'Olonne, il nous fallait prendre le train à la Gare Montparnasse, ce qui n'était pas à côté. Mais enfin on y arrivait.
En 1961, pour une réprimande qui n'était pas du tout justifiée, je donnai mes huit jours à mon principal patron, Monsieur Monas. Il voulut que je revienne sur ma décision mais je restai ferme.
Sur ces entrefaites, un voisin que je connaissais me proposa de devenir démonstrateur au BHV. J'acceptai, et pour la première fois, je vendis l'Electronic Starter, un appareil que l’on mettait sur le delco pour améliorer l’allumage. Je n’y connaissais absolument rien, mais en lisant les documentations, j’eus vite fait de me mettre au courant. En plus, j’écoutais les gens parler de leurs problèmes de voiture et j’en faisais profit. Cela dura un an et demi. Et, ma foi, sans rien y connaître mais grâce à mon bagou, je m'en suis fort bien tiré. En quelques semaines, j’étais devenu un bon8vendeur et je gagnais très bien ma vie. J'étais(payé cinq francs pour chaque pièce vendue.
En plus, je gardais toujours le repassage des tailleurs et des manteaux chez Monsieur Simon, que je faisais de très bonne heure le matin, ou le soir après mon travail au magasin. Au bout d'un0an et demi, la Société qui m'employait me diminua d'un franc cinquante par pièce, alors j'ai démissionné. J'ai voulu faire le représentant en articles de bazar mais cela n'a pas réussi, car il faut du temps pour se faire une clientèle. Or, comme j'avais une famille à nourrir, je ne pouvais pas attendre.
Nous sommes partis en vacances au mois d'août. Puis en septembre, j'ai commencé à vendre, toujours au BHV, des perceuses Silex et toute une gamme d'autres outils, jusqu'au mois de novembre. Puis j'ai vendu des trains électriques au Printemps pour les fêtes de Noël. En0réalité, cela aurait dû bien marcher, puisque j'avais les premiers mini-trains. Seulement, il n’y en avait déjà plus le 8 décembre, et le magasin n'en a pas recommandé à la maison qui m'employait (les Trains Lima). En fait, pour les derniers jours de vente de jouets, les clients achetaient n'importe quoi, et le chef de rayon ne voulait surtout pas qu'il)y ait du stock.
Vers le 15 janvier, je me retrouvai sans travail et c'est là que l'établissement qui m'avait employé pour l'Electronic Starter me rappela pour vendre des petites machines à laver portatives. Là encore, je fis un malheur. Partout où je passais, je faisais des ventes sensationnelles. Cela dura quatre mois, et puis j'ai eu un accident du travail qui m'a tenu à l'hôpital pendant un mois, durant lequel j'ai eu le genou dans le plâtre. J’ai donc dû m’arrêter de travailler. Quand je suis revenu au bout d’un mois et demi, j’avais été remplacé.
C'est cette année là que nos trois enfants majeurs se marièrent : Michel, qui avait quitté notre domicile, Gérard, et enfin Monique. Je venais juste de sortir de l'hôpital.
Je retrouvai une démonstration au BHV pour vendre du matériel Silex, des perceuses, des meuleuses et bien d’autres appareils. C’était pour un temps déterminé, jusqu’au 15 décembre. Ensuite je vendis des jouets pendant un mois, toujours au BHV, où je commençais à être connu.
Vers le 30 janvier de l’année 1967, j'ai trouvé une autre démonstration au rayon auto, les produits Abel pour le nettoyage et l'embellissement de la voiture. J’avais quatre produits à vendre : un pour le lavage, un pour le lustrage, un produit anti-goudron et un produit pour les chromes. Chacun de ces produits coûtait cinq francs. Pendant quatre mois, d'avril à juillet, je réussis à gagner assez bien, car j’avais trouvé une astuce. Au lieu de les vendre à l’unité, je faisais des lots. Et comme c'était la période des porte-clés, il y en avait un offert pour quatre produits achetés. Et cela a pas mal marché, jusqu’à la fin juillet.
Ensuite, comme c’était fini, nous sommes partis avec les enfants en vacances aux Sables d’Olonne. C’était un mois de repos bien mérité.
Début septembre, je retournai voir au BHV. Au bout de deux ou trois jours, on me proposa une démonstration de perceuses et d’accessoires adaptables chez Bosch. J’étais engagé pour les trois mois de l’exposition outillage. La discussion du salaire fut très dure, mais je m’en tirai fort bien. Au début, je proposai mille cent francs de fixe et trois pour cent de commission. Les patrons refusèrent alors je suis descendu à sept cents francs de fixe et cinq pour cent de commission. Là ils acceptèrent. Ils ne pensaient pas alors que j’allais faire un bon chiffre...
Or, les trois premières semaines, avec un matériel disons, moyen, je fis à peu près le même chiffre que les marques déjà implantées depuis longtemps au BHV. Et les mois suivants, je les battis régulièrement. Aussi, quand l’exposition outillage fut terminée, le magasin demanda à la Maison Bosch de poursuivre l’expérience, ce qui fut accordé. Et, en fait de trois mois, j'ai réussi à y rester sept ans...
Dans les mois qui suivirent, le matériel se développa et j’eus d’autres articles de qualité meilleure, des perceuses plus puissantes et des accessoires mieux adaptés. Aussi, mes ventes augmentaient régulièrement. Je commençais à respirer.
Et puis ce fut mai 68 et les grèves. Les magasins furent fermés pendant trois semaines. Nous, les démonstrateurs, nous n’avions aucun droit dans les magasins et souvent, si l’on ne plaisait pas au Chef de rayon, il nous renvoyait sans.aucune raison. Grâce à cette grève, nous avons pu obtenir d’être considérés comme des vendeurs du magasin, avec pratiquement les mêmes droits. C’était une plus grande tranquillité dans notre travail. Il faut dire c’était souvent les démonstrations qui faisaient vivre le rayon, par l’afflux de clientèle autour des stands.
Et puis ce fut la réouverture, avec un nouveau départ pour les ventes, et on vit changer la clientèle. Au début, lorsque je vendais tous un tas de choses différentes, les gens venaient de la banlieue nord ou est. A partir de ce"moment là, on eut des gens de Neuilly et du seizième, bref une clientèle plus riche.
C’est à cette époque que je proposai de faire entrer au rayon du matériel professionnel. Au début, ce fut timide, mais je réussis à proposer aux clients des perceuses, des scies et des ponceuses intégrales, à la place des accessoires adaptables sur les perceuses. Petit à petit, cela prit son essor. Alors la maison Bosch fabriqua des intégrales moins chères, ce qui me permit de faire un quart de mon chiffre d’affaires grâce à cela. De 1969 à 1974, je suks parti en vacances de neige avec le Comité d’Entreprise du BHV. Les deux premières années, nous sommes allés aux Monts Dore, skier au Puy de Sancy, puis à Chamrousse et aux Deux-Alpes. Nous étions toute une bande de copains, toujours les mêmes, et nous passions de très bons moments.
Ce furent des années d’embellie pour le commerce, donc pour nous. Mais toute médaille a son revers, car comme je gagnais bien ma vie, la maison Bosch m’augmenta mon fixe, qui passa à mille cent francs, mais ramena ma commission à trois pour cent. J’ai essayé de discuter, mais c’était à prendre ou à laisser. J’ai pris. Heureusement, les ventes augmentaient régulièrement, ce qui fait que je ne perdis pas de salaire.
Mais, la dernière année, ils m'enlevèrent le bénéfice de l'outillage professionnel, que j'avais réussi à imposer au BHV. Par ailleurs, à la fin du mois d’octobre 1974, le chef de rayon de l’outillage voulut nous obliger à changer nos heures de repas pour que les démonstrateurs s’occupent des ventes des autres marques. J’ai refusé, car les ventes les plus intéressantes se faisaient de 11 h 30 à 13 h 30. Ensuite, jusqu’à 15 h, il n’y avait pas grand chose à faire. Alors, par tous les moyens, le bureau a cherché à nous nuire. Ils y sont arrivés. A la fin de l’année, ce magasin, pour qui j'avais tant travaillé, à réussi à me faire renvoyer, soit disant pour faute grave. Je les ai attaqués aux Prud’hommes et, en avril 1975, j’ai eu gain de cause. Mais j’ai perdu une place que je n’ai jamais retrouvée...
Au début de l'année 1975, nous avions acheté un appartement au%84 de la rue Henri Barbusse aux Lilas. Comme je me suis retrouvé sans travail au mois de février, j'en ai profité pour le remettre en état, tout en4cherchant une autre place. Au mois d'avril, nous avons déménagé de la cité, laissant notre ancien appartement à Christine et Jean-Jacques, qui étaient bien contents.
Je suis resté plusieurs mois sans trouver une place intéressante. J'ai essayé d’abord le double-vitrage, qui semblait vouloir bien démarrer, car le bruit de la circulation près des grands axes devenait de plus en plus fort. J’ai essayé aussi la vente de poúles. Tout cela aurait pu marcher, car j'avais trouvé pas mal de clients. Mais ces patrons étaient tous des voleurs et je n’étais pas payé. Enfin, en octobre 1975, je suis devenu représentant dans le traitement de charpente contre les capricornes, ces insectes qui attaquent le bois. Après le salon du bricolage, où nous avons très bien vendu, j’ai eu à m’occuper du département 93, d’une partie de Paris et de la Marne. Au bout de deux ou trois mois de prospection, j’avais une bonne clientèle. Mais là encore je me suis fait avoir, car les deux derniers mois de travail, ceux qui étaient les plus importants, ne me furent pas payés.
Au mois de février¤1976, j'ai fait les Arts Ménagers au CNIT, à la Défense, chez Hoover, et j’ai pas mal réussi. Aussi, en avril de la même année, la maison qui m'avait employé me prit comme vendeur d’électroménager dans son magasin au Kremlin-Bicêtre. Ce magasin était vieux, mal entretenu, et pourtant il y avait toujours beaucoup de monde. En plus, l’été 1976 fut très chaud et les gens forçaient leurs réfrigérateurs, ce qui les$faisait griller. Alors, pendant deux mois, nous avons vendu une quantité incroyable de frigos. Dans l’ensemble, je gagnais assez bien ma vie. Ce n'était pas formidable, mais enfin je travaillais.
Nous étions trois vendeurs plus le patron. Il y avait une deuxième boutique à Choisy-le-Roi sur unu dalle et nous allions y travailler une semaine à tour de rôle. Il n’y avait pas grand chose à faire et, à la fin du mois, cela pesait sur notre sanaire. Cela a duré jusqu’en 1977, où, au printemps, le patron a fait refaire le magasin avec des lumières plus éclatantes. A partir de ce jour, la clientèle a fui, le magasin. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Toujours est-il qu’il y eut une récession des ventes. Comme j'étais le dernier arrivé, je fus le premier licencié. J’étais resté dans cette maison environ un an et demi.
Avant de retrouver quelque chose de stable, j’ai travaillé un peu pour Thomson électroménager à Melun, où j’ai animé une semaine commerciale, chez Marinelli, où j’ai fait de bonnes ventes, puis pour Indésit à Angers, où j’ai participé pendant quatre jours à l’ouverture d’un centre commercial. Après, j’ai fait tout un tas de petits boulots sur les marchés mais sans grande réussite.
Et puis, grâce à un copain qui m’a fait entrer chez Vedette, je suis devenu vendeur-démonstrateur itinérant. J'allais d'un magasin Conforama à un autre. Parfois c'était bon, et parfois médiocre. Il y en avait trois qui marchaient bien : Bondy, Sevran et Maisons-Alfort. Dans l’ensemble, je me débrouillais. Mais comme c'étaient des contrats à temps, je me trouvais souvent au chômage pendant quinze jours. Cela dura jusqu’au mois de décembre 1978. Là encore, coome je ne gagnais pas trop mal, ils voulurent me diminuer ma commission (qui était à trois pour cent). Etant donné que je venais d'avoir soixante ans, j'ai demandé mon certificat et fait valoir mes droits à la retraite (qui était en réalité la pré-retraite jusqu'à soixante-cinq ans).
Pendant plusieurs années, pour ne pas rester oisif, j'ai refait les peintures de mon appartement et de ceux de tous mes enfants, ce qui me permit de ne pas m'ennuyer. Je travaillais tous les matins et, l'après-midi, je jouais à la pétanque. Enfin, j’ai bricolé pas mal. En même temps, j’ai fait ma demande de retraite complémentaire. Pour remplir le dossier, j’ai dû faire appel à ma mémoire. Je n’avais que quelques certificats, une dizaine environ, alors que j’avais eu une vie de travail bien remplie : quarante-neuf patrons en quarante-neuf ans... Mais j’ai réussi à tout retrouver.
J’ai obtenu deux caisses de retraite complémentaire, le CIS et l’AGRR, grâce auxquelles ma femme et moi, nous sommes partis en vacances assez$souvent à des prix très intéressants : à Grâces, au Lavandou, au Pic du Canigou, à Vernet-les-Bains, à Barr en Alsace, etc. Avec les Associations des Lilas, nous avons été en Corse, à Calvi, pendant quinze jours, puis à Strasbourg quatre jours. Nous avons fait également un voyage sur le Rhin et avons visité quelques villes allemandes très pittoresques. L'été, nous allions en Normandie dans la maison de campagne de Monique et Jacques.
Le temps passa agréablement jusqu'en 1990, où j'ai eu de gros problèmes de santé. Græce à un nouveau docteur, qui avait découvert que j'avais un rein malade, j'ai pu être opéré au mois de juin. Je m'en suis bien remis, mais, en 1991, j’ai été atteint d'un cancer du poumon gauche.
Que dire de cette maladie ? Que c'est très grave...
Mais grâce à mon docteur, qui a su la déceler très tôt, à une équipe très performante à l'Hôpmtal Tenon et à des produits de chimiothérapie nouveaux (bien qu'ils rendent très malade), cela a réussi au bout de six mois. Je ne tenais plus qu'à un fil. Heureusement que Julienne était près de moi, ainsi que le Docteur Hazan, à qui je dois beaucoup. C'est grâce à eux si j'ai tenu le coup.
A l'Hôpital Tenon, le Docteur Milleron puis le Docteur Terrioux se sont occupés de moi et, tous les quinze jours, j'étais dans leurs services. Après des séances prolongées de chimio, qui duraient cinq heures, je rentrais complètement épuisé, avec des nausées prolongées. Cela dura du 22 octobre 1991 au 15 février 1992. Là, comme j’étais dans un état très bas, les docteurs se sont consultés. Je n'avais plus que deux millions de globules rouges et pratiquement plus de globules blancs. Ils me firent une transfusion sanguine assez importante et, dès l'après-midi, j'allais un peu mieux.
Ensuite, comme mon poumon était en voie de guérison, ils changèrent de soins. Je n'avais plus qu'une demi-heure de chimio. Cela réussit très bien. Ils étaient très satisfaits du résultat, car je reprenais des forces et le cancer continuait de régresser. Pourtant, j'ai eu des soins pendant encore un an et demi, ce qui était très stressant.
A la fin du mois de septembre 1993, après des soins très durs, où j'ai bien cru perdre la vie, j’étais enfin guéri. Le Docteur Terrioux décida d'arrêter et là, j'ai poussé un « ouf » de soulagement. Mais, malgré tout, je reste sous surveillance très serrée. On me fait toujours des examens tous les deux ou trois mois, par mesure de sécurité.
Maintenant, en 1994, j'ai repris toutes mes forces, et je me sens en pleine forme. |
| © 2015 |

